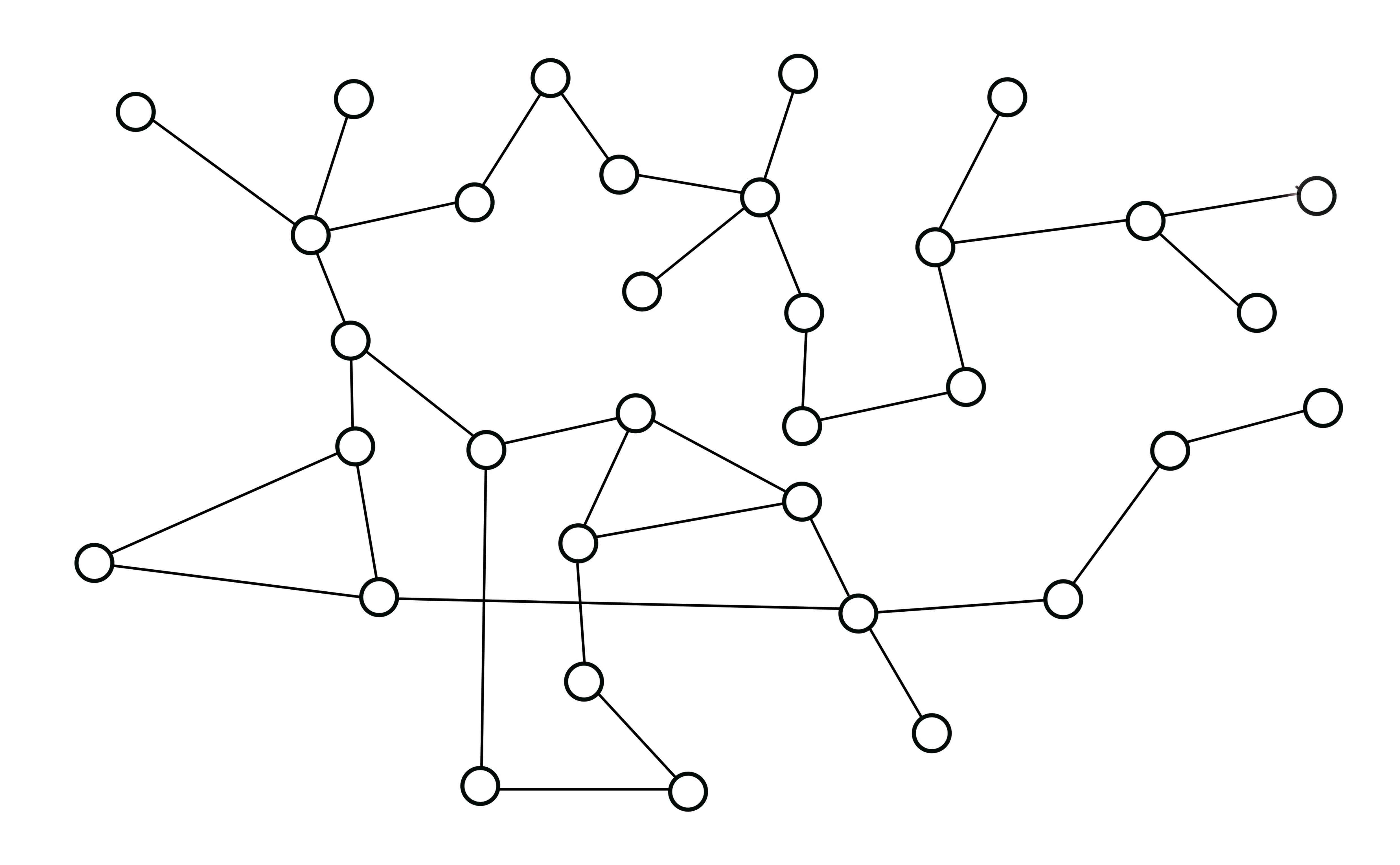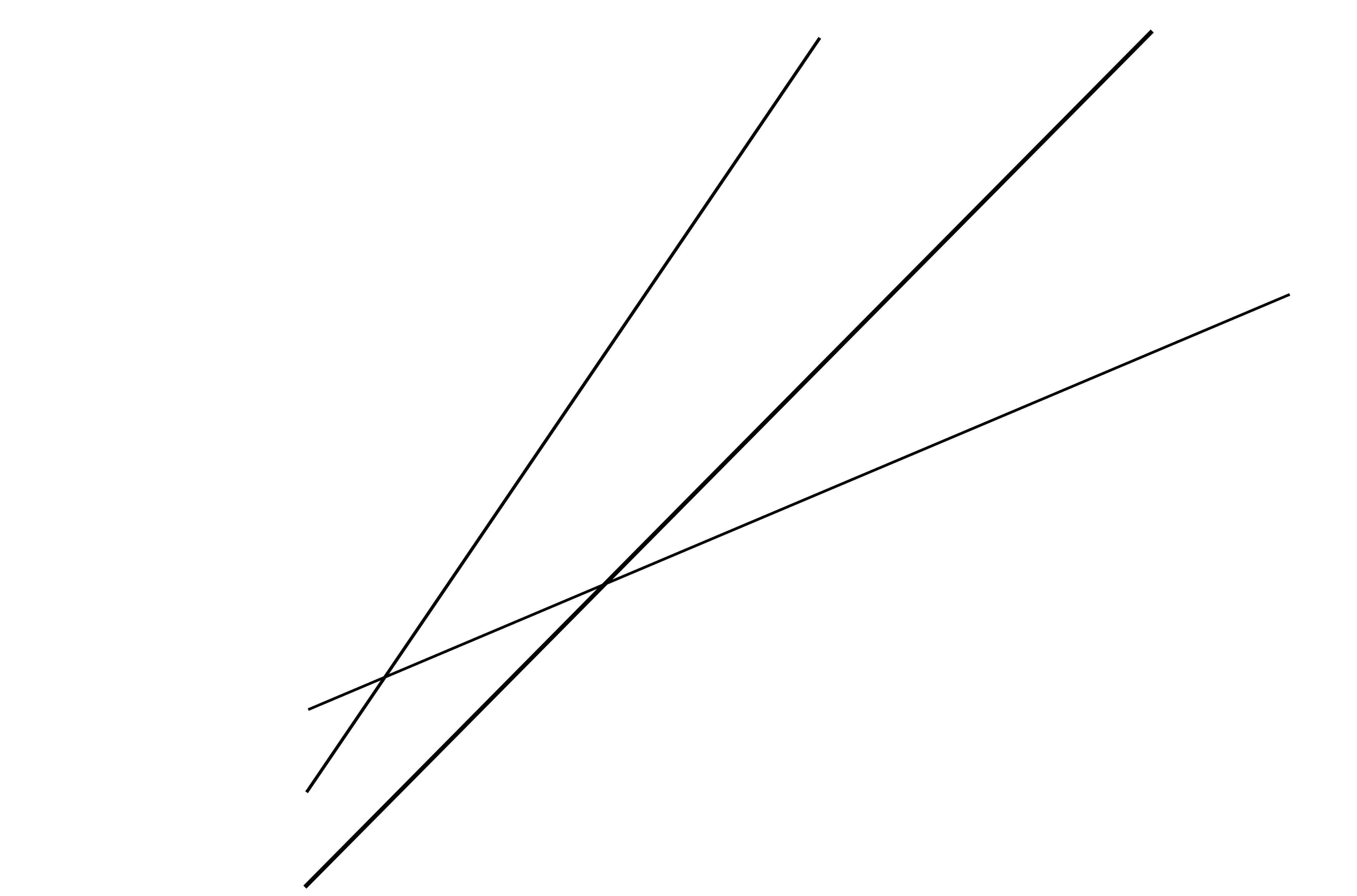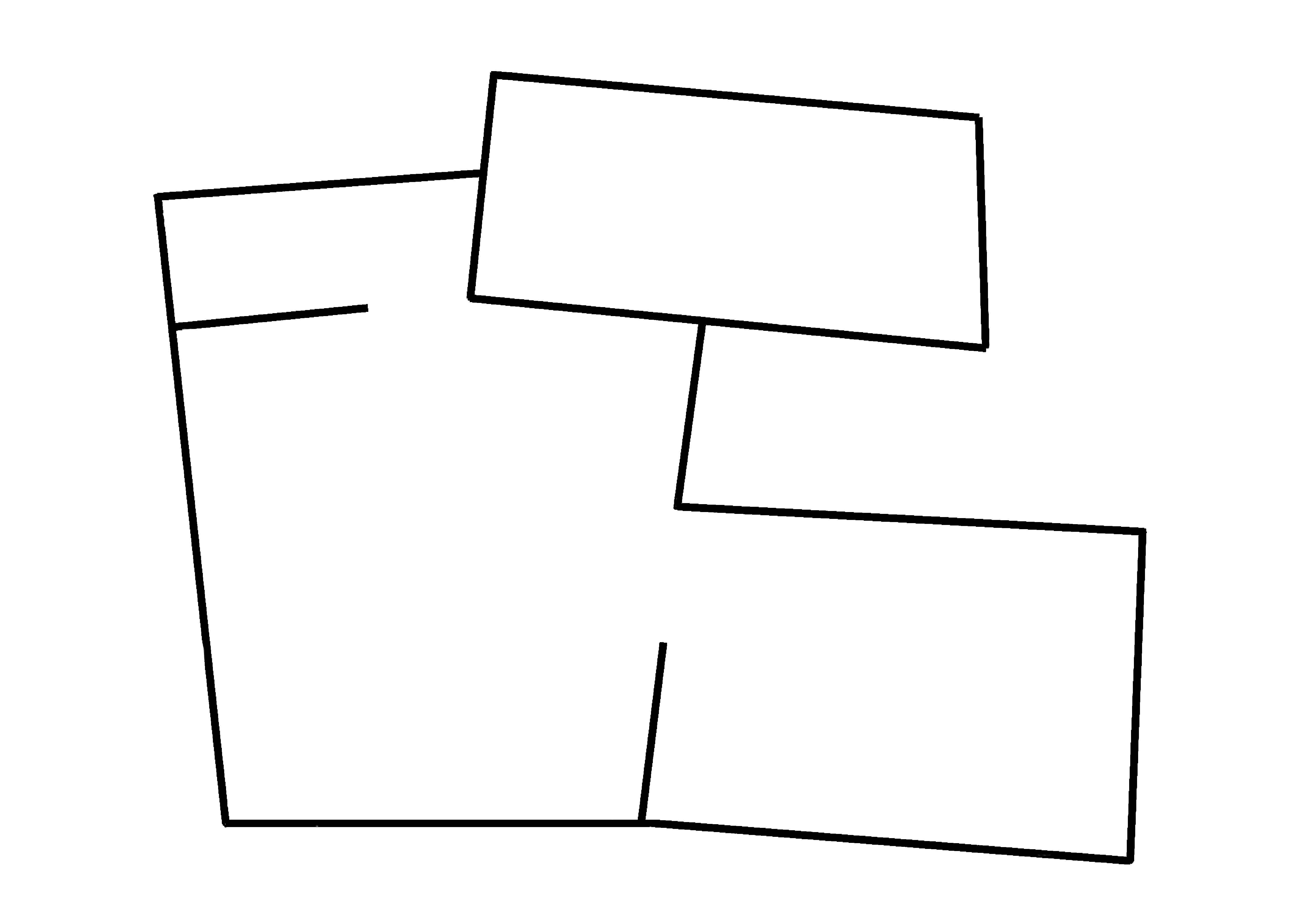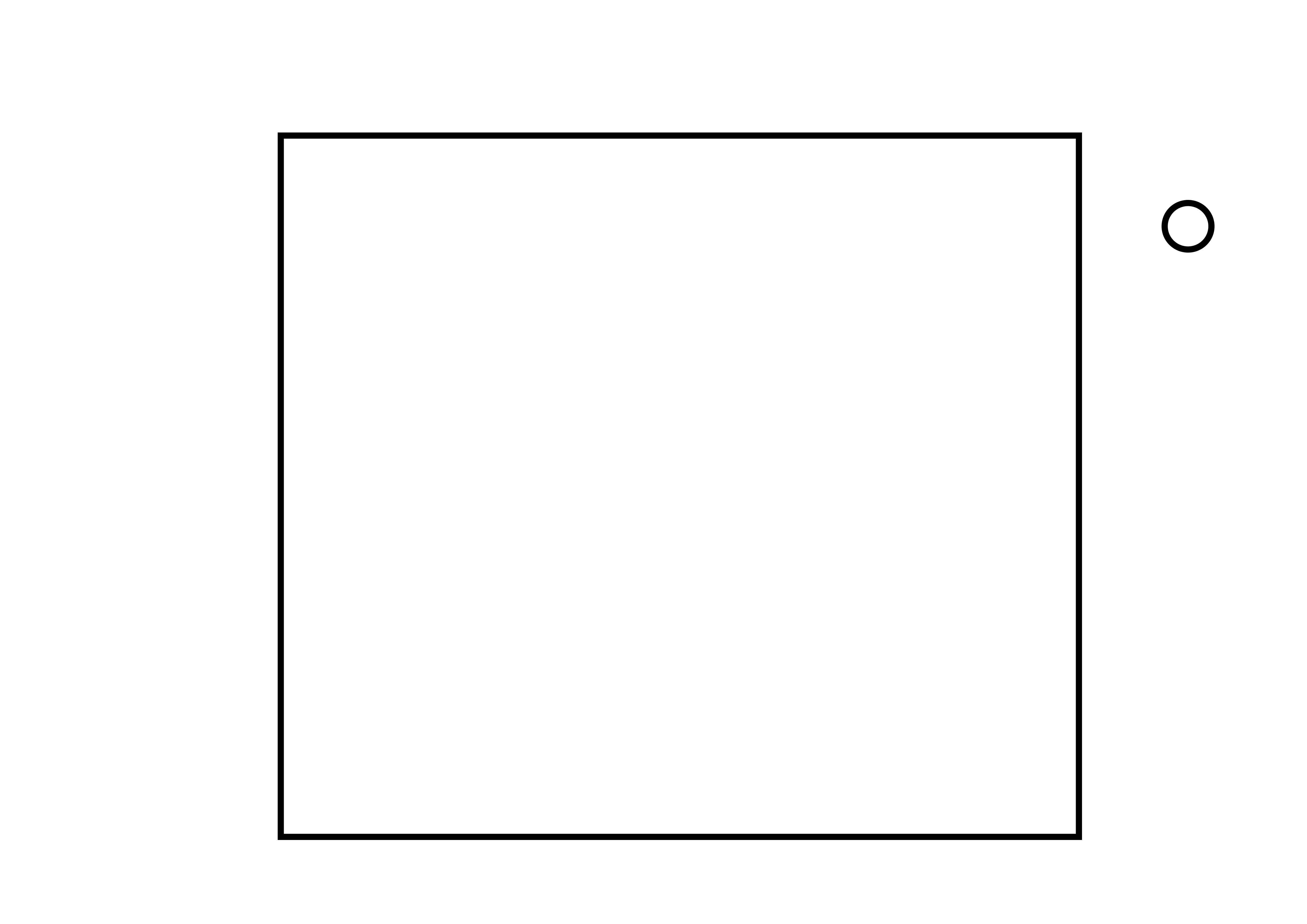Égalité, Hybridité, Ambivalence
Projet de recherches de L'EsadTpm 2015-2016
Réticents à opposer certaines thèses fondatrices du modernisme aux outils théoriques développés autour des cultural studies que nous considérons tout aussi opératoires.
L’enjeu principal de ce projet de recherche serait de tracer les généalogies, les déplacements, les migrations, les liens théoriques et les œuvres entre ce que nous pouvons appeler, d’un coté, un principe d’égalité comme principe éthique, politique et esthétique, et les notions telles que hybridité, ambivalence et décentrage de l’autre.
L'égalitarisme est une tendance caractéristique d’une modernité caractérisée, depuis
l'âge des révolutions jusqu'à la guerre froide, par des signes singuliers tels le développement
de la science et des technologies, l'industrialisation, l'urbanisation, l'alphabétisation, la prolifération des médias de masse, l'instauration de la démocratie représentative, l'émergence de l'individualisme et, paradoxalement, l'essor des mouvements sociaux...
Depuis la fin du XIXe siècle, et les débuts du modernisme justement, on a pu observer un accroissement de cette dernière inclination cristallisée par l'apparition ou l'amplification des processus de libération dont de nombreux phénomènes ont témoignés : mouvements paysan et ouvrier, révolution prolétarienne, institution de la grève, féminisme, révolution des mœurs amoureuses, pacifisme, émancipation des minorités, désobéissance civile, mouvement pour les droits civiques, courant hippie, revendications identitaires, free speech movement, draft, resistance, etc.
Tous révèlent le cours lent et douloureux de la liquidation des privilèges, de l'abolition
des inégalités et des discriminations sociales, raciales, sexuelles, nationales. Mais cette tendance égalitaire qui a imprégné la société semble aussi avoir coïncidé avec les aspirations de l'art, celles des avants-gardes en particulier, à des niveaux très divers et au sein de courants parfois opposés. L'énoncé de Wladislaw Strzemiński (« chaque cm2 du tableau a la même valeur ») pourrait aussi bien servir d'exergue à un tableau all over de Jackson Pollock, une composition de John Cage, un collage de Kurt Schwitters, ou un monochrome d'Ad Reinhardt. De fait, certains mouvements artistiques parmi les moins "formalistes" (futurisme – par certains aspects –, dadaïsme, situationnisme, Land Art, art corporel, Fluxus...) étaient par nature enracinés dans un questionnement politique explicite.
N'ayant cessé d'assimiler le hors-champ de l'art en élargissant par la même occasion sa définition, ces courants-là auront
d'ailleurs largement contribué à légitimer le terrain occupé plus tard par des pans entiers de pratiques instituées comme la performance ou la vidéo.
Malgré l’incontestable crise subie par cette tendance, qui commençait déjà à s’estomper dans le milieu des années soixante-dix au point de disparaître complètement des mémoires vingt ans plus tard, il nous est apparu opportun de l’interroger de nouveau à travers ce projet de recherche.
Afin de mieux l’actualiser dans une ère «post» moderne, nous
pensons que les outils développés par les théoriciens des
cultural studies
et plus particulièrement des études postcoloniales et celles du genre sont toute à fait opératoires surtout en ce qui concerne les paradoxes qu’ils vont nécessairement faire émerger et qu’il s’agira, dans le cadre du projet de recherche, de dialectiser.
En effet, la globalisation des flux économiques, informationnels et migratoires ne peut qu’engendrer à son tour ce que nous pouvons appeler un tournant spatial de l’art contemporain*.
Ces flux culturels ont contribué à la fluidité, la stratification, l’hybridité qui semble caractériser l’art contemporain aujourd’hui.
Hybridité et ambivalence font partie d’un lexique que nous considérons pertinent à explorer et qui nécessitera obligatoirement un retour sur l’historiographie de l’art.
Partant des écrits du philosophe Manuel De Landa, ce
cycle explore les méthodologies délinéarisant l’écriture de l’Histoire. En effet depuis de nombreuses années les artistes ont interrogé la notion même de l’histoire à travers des pratiques aussi diverses que le re-enactment, l’archive, le document performatif, une histoire spéculative, fictionnée ou uchronique.
Nous pensons à des artistes tels que Peter Watkins,
Jeremy Deller,
Alejandra Riera
ou Walid Raad.
Outre le nécessaire retour sur l’histoire de l’art auquel ce projet de recherche donnera lieu, il s’agira également d’envisager l’actualisation des problématiques à partir desquelles «le principe d’égalité» se met en œuvre. Cette démarche implique l’abord d’un certain nombre de notions éventuellement contradictoires qui contribuent à forger – par défaut –
le concept d’égalité, qu’elles s’en approchent (indifférence, constance, invariabilité, permanence, neutralité, anonymat, équivalence, régularité, unité, uniformité, objectivité, présentation, autonomie, quantité, nature, etc.), ou s’y opposent (hiérarchie, discrimination, distinction, différenciation, ordre, autorité, gradation, domination, soumission, subordination, pouvoir, puissance, hégémonie, illusion, imitation, représentation, composition, qualité,
culture, etc.), selon l’agencement des valeurs différentes
qui leurs sont pourtant communes.
*Geoesthetiques, ouvrage sous la direction de Kantuta Quirós & Aliocha Imhoff, une coproduction de l’Ecole Supérieure d’Art de Clermont Métropole, Parc Saint Léger-Centre d'art contemporain, École Nationale Supérieure d’Art de Dijon, Edition : B42, décembre 2013.